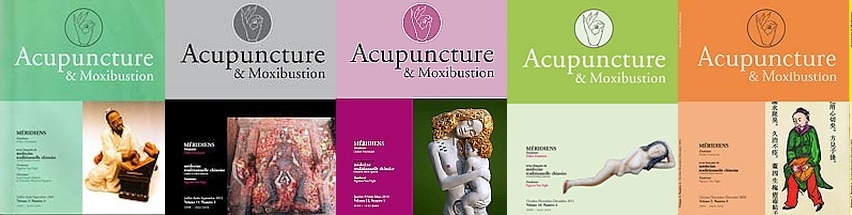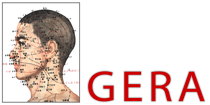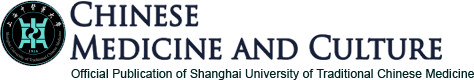Evaluation de l’acupuncture
Evaluation de l’acupuncture
Landgren K, Hallström I, Tiberg I. The effect of two types of minimal acupuncture on stooling, sleeping and feeding in infants with colic: secondary analysis of a multicentre RCT in Sweden (ACU-COL). Acupunct Med. 2021 Apr;39(2):106-115.
Résumé
Question
Dans cette récente publication en 2021 du même essai ACU-COL (déjà publié en 2017 [[1]]), les auteurs font une analyse secondaire de l’efficacité de deux types d’acupuncture minimaliste par rapport à l’absence d’acupuncture sur les habitudes de selles, de sommeil et d'alimentation chez des nourrissons atteints de coliques infantiles.
Plan Expérimental
Essai randomisé à trois bras, réalisé en double aveugle chez 147 nourrissons, selon un protocole publié en 2015 [[2]].
- groupe A (n=48) : acupuncture standardisée au point 4GI (hegu) pendant 5 secondes,
- groupe B (n = 49) : acupuncture semi-standardisée en fonction des symptômes (5 points au maximum) pendant 30 secondes.
- groupe C (n = 48) : ne bénéficie pas d'acupuncture.
Cadre
Quatre centres médicaux pédiatriques localisés dans quatre comtés en Suède, où sont proposés gratuitement pour tout bébé pendant les trois premiers mois de vie sept visites pour les peser et mesurer. Lors de ces visites, les parents reçoivent des conseils de prise en charge de routine. Les parents de nourrissons qui pleurent excessivement sont informés de l’essai par acupuncture.
Patients
147 nourrissons âgés de 2 à 8 semaines recrutés entre janvier 2013 et mai 2015.
Critères d’inclusion : Les nourrissons éligibles sont ceux qui, d’après les déclarations de leurs parents dans un journal lors de la semaine de référence ont présenté, pendant plus de trois jours, des pleurs et/ou une agitation pendant plus de trois heures par jour. Ils doivent être en bonne santé avec un gain de poids approprié. Par ailleurs, ils doivent avoir déjà essayé un régime excluant les protéines du lait de vache et/ou un régime approprié pendant au moins cinq jours.
Critères d’exclusion : Sont exclus de l’étude les nourrissons nés avant 37 semaines de gestation, ou ayant déjà reçu tout type de prescription médicamenteuse ou ayant déjà essayé l'acupuncture.
Intervention
Les parents qui veulent participer prennent contact avec le chef de projet et commencent à noter chaque jour de façon détaillée pendant une semaine (semaine de référence) les états d’agitation et les pleurs de leur bébé dans un journal santé. Si l'enfant remplit les critères, il/elle peut être inclus(e).
Les parents des bébés inclus continuent à noter de façon détaillée dans le journal pendant les deux semaines de traitement par acupuncture, ainsi que pendant la période de surveillance qui prend fin à la suite d’un entretien téléphonique se déroulant trois jours après le dernier jour de traitement par acupuncture. Ces données sont comparées à celles de la semaine de référence.
Lors de la première visite, l'infirmière recueille le consentement éclairé et les données de base. À chacune des visites suivantes (et par téléphone pour la période de surveillance), les parents sont interrogés sur les changements observés au niveau des pleurs, des selles et du sommeil de leur bébé, ainsi que tout effet secondaire associé à l'acupuncture.
- Groupe A : acupuncture standardisée. Aiguille insérée au point 4GI (hegu) à une profondeur d’environ 3 mm unilatéralement pendant 2 à 5 secondes, puis retirée sans stimulation.
- Groupe B : acupuncture personnalisée semi-standardisée, selon la pratique clinique de la MTC. Les acupuncteurs peuvent choisir n'importe quelle combinaison de points : sifeng[1], 4GI et 36E (zusanli), selon les symptômes rapportés dans le journal par les parents. Un maximum de cinq insertions est toléré par séance de traitement. Pour sifeng, quatre insertions, chacune à une profondeur d'environ 1 mm pendant 1 seconde. Aux points 4GI et 36E, les aiguilles sont insérées à une profondeur d'environ 3 mm, uni ou bilatéralement. Les aiguilles peuvent être laissées pendant 30 secondes. La sensation de deqi n'est pas recherchée.
- Groupe C : les nourrissons restent 5 min seuls avec l'acupuncteur sans recevoir aucun traitement par acupuncture.
Ainsi, parallèlement à la prise en charge habituelle, les nourrissons inclus bénéficient de quatre visites supplémentaires (deux fois par semaine pendant les deux semaines de traitement) à leur centre de santé habituel. Les mères qui allaitent sont encouragées à continuer l’allaitement maternel.
Lors de ces visites supplémentaires, les parents discutent pendant 20 à 30 minutes avec une infirmière sur les symptômes de leur bébé.
À chaque visite pendant les deux semaines de traitement, l'infirmière de l'étude porte l'enfant dans une salle de traitement séparée où l’enfant reste seul avec l'acupuncteur pendant 5 min. L’acupuncteur traite le bébé selon le groupe d'attribution et enregistre les procédures de traitement et tout événement indésirable.
Critères de jugement
Les modifications de fréquence des selles et d'heures de sommeil par jour sont évaluées. Les données sont collectées en utilisant : (1) le journal santé soigneusement rempli par les parents à la semaine de référence, pendant les deux semaines de traitement et la semaine de surveillance ; (2) les questionnaires avec des composantes quantitatives et qualitatives, utilisés lors des deuxième et quatrième visites et lors de l’appel téléphonique de suivi.
Résultats
D’après les données recueillies dans les journaux de suivi - concernant les selles, l'alimentation ou le sommeil - aucune différence entre les trois groupes n’a été observée. Cependant, lors de l'appel téléphonique de suivi, davantage de parents des groupes A et B (par rapport au groupe C) signalaient que l'alimentation et le sommeil avaient changé et que les symptômes de coliques s’étaient améliorés.
Conclusion
Des études supplémentaires seraient nécessaires pour préciser les meilleurs emplacements des points d’insertion d’acupuncture, le temps de stimulation ainsi que la durée du traitement.
Commentaires
Dans la précédente étude publiée en 2017, les mêmes auteurs rapportaient une diminution de la durée du temps de pleurs dans les deux groupes traités par acupuncture (efficacité similaire) par rapport au groupe témoin ne recevant pas d’acupuncture. Dans cette nouvelle et récente publication parue en avril 2021 [[3]], ils rapportent les résultats complémentaires de l’analyse secondaire de cette étude AcuCol de 2017 [1], concernant cette fois-ci les coliques infantiles.
L’analyse complémentaire [3] observe versus groupe témoin l'effet de ces deux types d'acupuncture (A et B) sur les habitudes de selles, de sommeil et d'alimentation chez les 147 nourrissons inclus parmi les 426 nourrissons examinés pour l'admissibilité. Finalement, aucune différence significative entre les trois groupes n’a été observée.
Néanmoins, les nourrissons inclus ont bénéficié de quatre visites supplémentaires en dehors des visites habituelles au centre de santé infantile.
Les modifications de fréquence des selles et d'heures de sommeil par jour ont été évaluées. Les données sont collectées en utilisant : (1) le journal santé rempli par les parents à la semaine de référence, pendant les deux semaines de traitement et la semaine de surveillance ; (2) des questionnaires avec composantes quantitatives et qualitatives, utilisés à la deuxième et quatrième visite et lors de l’appel téléphonique de suivi.
D’après les données recueillies dans les journaux tenus par les parents, aucune différence concernant les selles, l'alimentation ou le sommeil entre les trois groupes n’a été observée. En revanche, lors de l'appel téléphonique de suivi, davantage de parents des groupes A et B (par rapport au groupe C) ont signalé un changement dans l'alimentation et le sommeil et une amélioration des symptômes de coliques.
La colique infantile est une affection caractérisée par des pleurs excessifs au cours des premiers mois de la vie, entraînant une détérioration considérable de la qualité de vie des nourrissons et de leurs parents. Le nourrisson présente des paroxysmes de pleurs inconsolables dépassant trois heures par jour, trois jours par semaine, pendant plus de trois semaines. Les pleurs excessifs chez les nourrissons sont un problème pour 10 à 20% des familles, provoquant un climat de stress dans la cellule familiale. Les causes des coliques infantiles ne sont pas vraiment connues. On pense que cela peut être en rapport avec altération de la microflore fécale, une intolérance aux protéines ou au lactose du lait de vache, une immaturité ou une inflammation gastro-intestinale, une sécrétion accrue de sérotonine, une mauvaise technique d’alimentation, le tabagisme de la maman, etc. [[4]].
Dans certains cas, la colique peut être résolue si les protéines du lait de vache sont éliminées. Des compléments nutritionnels de Lactobacillus reuteri peuvent également être utilisés avec un certain succès. En revanche, l'efficacité et l'innocuité des autres types de traitements, comme la siméticone, la dicyclomine, les inhibiteurs de la pompe à protons (oméprazole..) restent à prouver. Il est plausible que l'acupuncture puisse avoir des effets positifs sur les coliques infantiles car elle est reconnue pour son effet calmant, pour réduire la douleur et restaurer la fonction gastro-intestinale [4].
Cakmak [[5]], quant à lui, pense que des indices physiopathologiques indiquent que la colique infantile est une pathologie partagée entre la mère et le bébé, en particulier dans le cas des mères allaitantes. La théorie qu’il propose implique les taux trop élevés de la TNFα (facteur de nécrose tumorale-alpha, importante cytokine impliquée dans l’inflammation) dans le lait maternel, ce qui influencerait le métabolisme de la mélatonine (en diminution) et de la sérotonine (en augmentation) chez le bébé, pouvant alors engendrer les coliques infantiles. La TNFα peut être normalisée soit en puncturant uniquement la mère qui allaite, soit, par puncture également du bébé. Et diminuer par acupuncture la concentration de TNFα engendrerait donc une augmentation de la production nocturne de mélatonine, normalisant ainsi les taux de sérotonine du nourrisson par effet inhibiteur du TNFα sur le recaptage de la sérotonine.
Le manque de connaissances sur la physiopathologie des coliques infantiles limite toutefois le développement de médicaments efficaces ainsi que des modalités de prise en charge par l'acupuncture.
L'acupuncture est utilisée en Scandinavie comme traitement des coliques infantiles. D’après les résultats d’un ECR en aveugle (n=90 nourrissons) réalisé en 2013 [[6]], concernant la mesure du temps des pleurs entre un groupe acupuncture (sur E36 - zusanli) versus un groupe témoin sans acupuncture, il est objectivé une tendance en faveur du groupe acupuncture, avec une réduction moyenne (par rapport à l’inclusion) de 13 minutes (IC à 95% -24 à + 51), mais non significative pour être considérée comme cliniquement pertinent.
Depuis la publication de l’étude AcuCol en 2017 [1], deux revues systématiques relatives aux coliques infantiles ont été réalisées.
La première méta-analyse réalisée en 2018 par des auteurs norvégiens et suédois sur le rôle de l'acupuncture dans le traitement des coliques infantiles est controversée dans le sens où les ECR disponibles sont à petits effectifs et présentent des résultats contradictoires ; et que d’autre part, d’un point de vue éthique, on ne peut disposer que du consentement des parents.
Ainsi sur les trois essais comparatifs randomisés (n=307), un seul a obtenu une mise en aveugle complète des évaluateurs des résultats dans les groupes d’acupuncture et témoin. La différence moyenne (MD) dans le temps de pleurs entre le groupe acupuncture et le groupe témoin était -24,9 min (intervalle de confiance de 95%, IC : -46,2 à -3,6) ; à mi-traitement, -11,4 min (IC à 95% : -31,8 à 9,0) et à la fin du traitement -11,8 min (IC à 95% : -62,9 à 39,2 sur un seul ECR) au suivi de 4 semaines. L’hétérogénéité était négligeable dans toutes les analyses. Bref, dans cette méta-analyse, on n’observe pas de différence cliniquement importante entre le groupe des nourrissons recevant l'acupuncture et le groupe témoin.
Par ailleurs, les données indiquent que l'acupuncture induit une certaine douleur de traitement chez de nombreux nourrissons. Les auteurs ont conclu que l'acupuncture percutanée à l'aiguille ne doit pas être recommandée pour le traitement des coliques infantiles de manière générale [[7]].
Également en 2018, des auteurs coréens ont publié une revue systématique sur le sujet, mais pas de méta-analyse, en raison de l'hétérogénéité clinique considérable des études réalisées chez des nourrissons âgés de 0 à 25 semaines atteints de coliques infantiles. Sur les 601 ECR identifiés, seuls quatre ECR, tous menés dans des pays d'Europe du Nord, ont été inclus. Une acupuncture minimaliste au point 4GI (hegu) ou 36E (zusanli) sans forte stimulation a été utilisée dans toutes les études. D'après l'analyse narrative des parents, l'acupuncture semble être efficace pour soulager les symptômes des coliques, y compris les pleurs et les problèmes d'alimentation et de selles, et ne présente que des effets indésirables mineurs. Cependant, les preuves cliniques n'ont pas pu être confirmées en raison de l'hétérogénéité clinique considérable et de la petite taille des échantillons des études incluses [[8]].
En septembre 2020, Hjern et coll. ont évalué toutes les preuves d’interventions, en prévention ou en thérapeutique pour les coliques infantiles. Ils confirment à nouveau que les quatre ECR d’acupuncture sont sans effet ou avec un effet minimal sur la durée des pleurs et que le Lactobacillus reuteri serait davantage un traitement prometteur pour les coliques infantiles mais à confirmer avec des ECR de plus grande puissance [[9]].
Néanmoins, il est plausible que l'acupuncture puisse avoir des effets positifs sur les coliques infantiles car elle est reconnue pour son effet calmant, pour réduire la douleur et restaurer la fonction gastro-intestinale. Dans les ECR, le traitement est de courte durée et standardisé et par conséquent ne reflète sans doute pas ce qui est pratiqué dans la vraie vie, comme on a pu le constater avec cette analyse secondaire de Landgren [3]. Des effets positifs de l'acupuncture ont été rapportés pour soulager la douleur et l'agitation lorsqu'elle est pratiquée par des acupuncteurs qualifiés qui adaptent chaque traitement à la symptomatologie du nourrisson telle que rapportée par les parents.
Les points 4GI et 36E, tous deux considérés comme importants dans le traitement des symptômes gastro-intestinaux et coliques infantiles, figurent parmi les points les plus utilisés. Par ailleurs, les points sifeng sont classiquement indiqués dans les troubles de la digestion chez l’enfant et sont considérés comme fournissant un stimulus plus efficace mais aussi plus douloureux. L'acupuncture minimaliste, une technique douce sans recherche de deqi est principalement utilisée pour traiter les coliques infantiles.
Il n'existe actuellement aucune preuve concluante sur l'efficacité de l'acupuncture pour traiter les coliques infantiles. Des ECR à plus grand effectif et plus solides sur le plan méthodologique sont nécessaires pour préciser les meilleurs emplacements des points d’insertion d’acupuncture, le temps de stimulation ainsi que de la durée du traitement.
On peut toutefois noter que l’acupuncture japonaise chez le nourrisson (shonishin) [2] pourrait être utile. Néanmoins, contrairement à l’acupuncture traditionnelle chez l’enfant dont l’efficacité commence à être évaluée, le shonishin ne l’est toujours pas [[10]].
Jean-Marc Stéphan, Tuy Nga Brignol
Notes
[1]. Sifeng est un point hors-méridien (Ex-UE-10), situé sur la face palmaire de chaque doigt (à l’exception du pouce), au milieu des plis transversaux de l’articulation inter-phalangienne proximale. Il est considéré harmoniser la circulation du qi entre le Réchauffeur Supérieur et le Réchauffeur Moyen
[2]. Le shonishin se pratique essentiellement sur le nourrisson, le bébé et le jeune enfant. Le soin bref, variant d’une à cinq minutes, voire à une vingtaine de minutes pour un enfant plus vieux est réalisé par le médecin. Après un petit apprentissage, la mère ou le père pourront même poursuivre le traitement à la maison. Mise au point au XVIIe siècle, cette technique acupuncturale spécialisée pour les enfants était pratiquée à Osaka au Japon. Mais initialement, c’est dans le Huangdi neijing lingshu et spécialement dans le premier chapitre « Des neuf aiguilles » que l’on retrouve en fonction de leur forme et de leur emploi différents une catégorie d’aiguilles en forme de bâton : aiguilles à tête ronde (yuan) et aiguilles émoussées (ti), non blessantes, utilisées pour masser et presser les points.
Références
[1]. Landgren K, Hallström I. Effect of minimal acupuncture for infantile colic: a multicentre, three-armed, single-blind, randomised controlled trial (ACU-COL). Acupunct Med. 2017 Jun;35(3):171-179.
[2]. Landgren K, Tiberg I, Hallström I. Standardized minimal acupuncture, individualized acupuncture, and no acupuncture for infantile colic: study protocol for a multicenter randomized controlled trial - ACU-COL. BMC Complement Altern Med. 2015 Sep 14;15:325.
[3]. Landgren K, Hallström I, Tiberg I. The effect of two types of minimal acupuncture on stooling, sleeping and feeding in infants with colic: secondary analysis of a multicentre RCT in Sweden (ACU-COL). Acupunct Med. 2021 Apr;39(2):106-115.
[4]. Johnson JD, Cocker K, Chang E. Infantile Colic: Recognition and Treatment. Am Fam Physician. 2015 Oct 1;92(7):577-82.
[5]. Cakmak YO. Infantile colic: exploring the potential role of maternal acupuncture. Acupunct Med. 2011 Dec;29(4):295-7.
[6] . Skjeie H, Skonnord T, Fetveit A, Brekke M. Acupuncture for infantile colic: a blinding-validated, randomized controlled multicentre trial in general practice. Scand J Prim Health Care. 2013 Dec;31(4):190-6.
[7]. Skjeie H, Skonnord T, Brekke M, Klovning A, Fetveit A, Landgren K, Hallström IK, Brurberg KG. Acupuncture treatments for infantile colic: a systematic review and individual patient data meta-analysis of blinding test validated randomised controlled trials. Scand J Prim Health Care. 2018 Mar;36(1):56-69.
[8]. Lee D, Lee H, Kim J, Kim T, Sung S, Leem J, Kim TH. Acupuncture for Infantile Colic: A Systematic Review of Randomised Controlled Trials. Evid Based Complement Alternat Med. 2018 Oct 24;2018:7526234.
[9]. Hjern A, Lindblom K, Reuter A, Silfverdal SA. A systematic review of prevention and treatment of infantile colic. Acta Paediatr. 2020 Sep;109(9):1733-1744.
[10]. Stéphan JM. Recension. Shonishin : Japanese pediatric acupuncture par Stephen Birch. Acupuncture & Moxibustion. 2016;15(4):333.


 Evaluation de l’acupuncture
Evaluation de l’acupuncture